Évolution des Think Tanks et leur classement mondial : le cas Haïtien
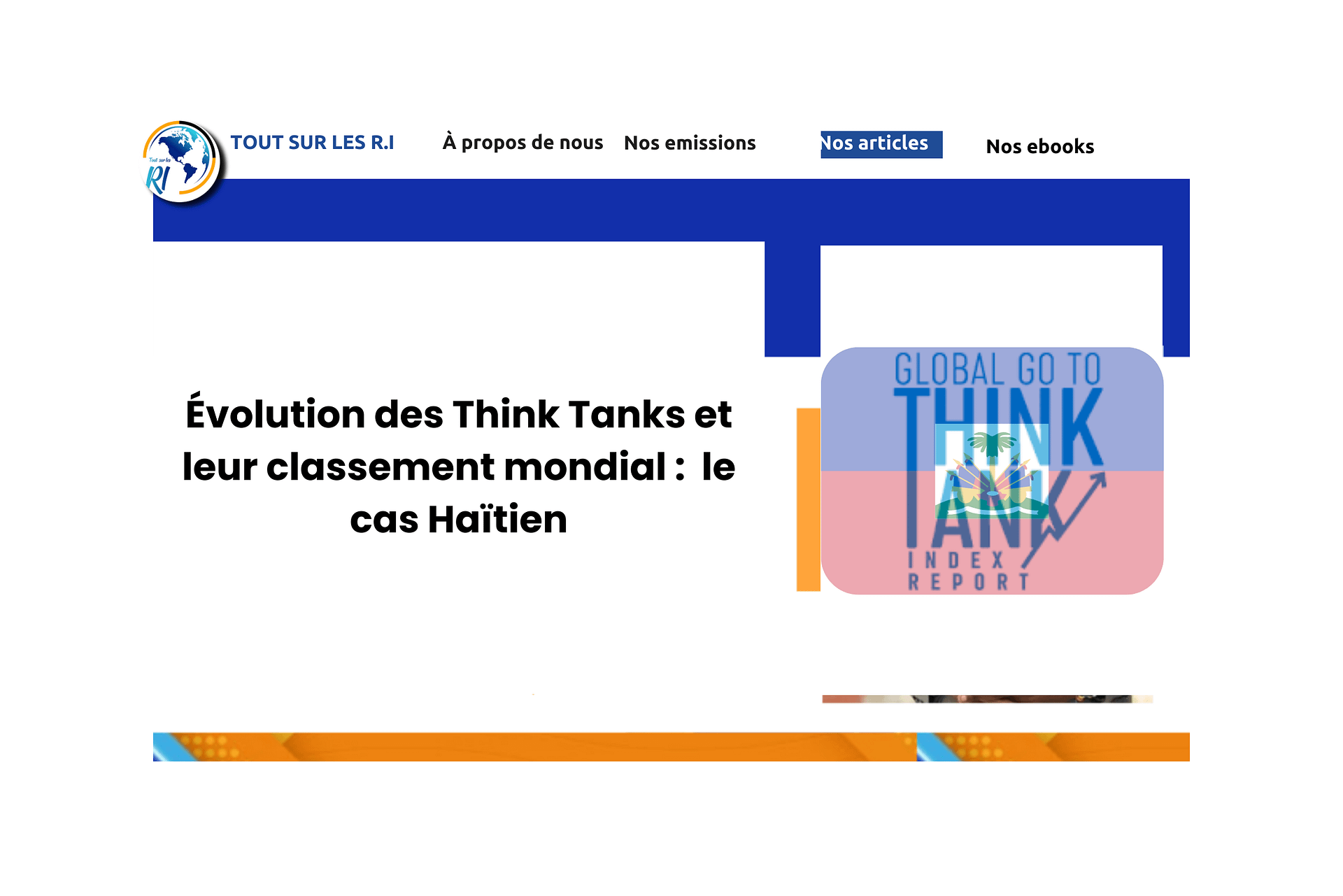
La Disparition du Dr Jim McGann et ses conséquences
Le 25 novembre 2021, la communauté scientifique internationale et le programme Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) de l’Université de Pennsylvanie ont été endeuillés par le décès du Dr Jim McGann. Cette perte a eu des répercussions profondes sur le fonctionnement du programme, entraînant notamment la suspension du classement annuel des think tanks pour l’année 2021.
Genèse et objectifs du classement des Think Tanks
Créé en 1989, le Think Tanks and Civil Societies Program de l’Université de Pennsylvanie vise à analyser la contribution des think tanks à la prise de décision en matière de politiques publiques. Ce n’est qu’à partir de 2006 que l’initiative de classement a vu le jour, sous l’appellation Global Go To Think Tank Index. Ce classement vise à identifier et à reconnaître les centres d’excellence dans les grands domaines des politiques publiques et dans toutes les régions du monde.
Le premier rapport fut publié en 2008, résultat d’un processus rigoureux et transparent. Le TTCSP précise que ce classement n’est pas une évaluation absolue de la qualité ou de l’efficacité des organisations, mais plutôt une tentative de mettre en lumière les principaux groupes de réflexion mondiaux.
Processus de classement et critères d’évaluation
Entre avril et août 2020, un appel à candidatures a été lancé afin de recruter des experts pour siéger au sein des panels régionaux et fonctionnels du classement. Parallèlement, une équipe de 70 chercheurs a procédé à la mise à jour de la base de données du Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP), garantissant ainsi une couverture exhaustive des think tanks à évaluer.
Dans le cadre de cette initiative, plus de 8 100 think tanks, ainsi que 12 800 journalistes, donateurs et décideurs politiques à travers le monde, ont été sollicités pour soumettre des nominations. Les structures ayant obtenu au moins 10 nominations ont été retenues pour la phase suivante. Par ailleurs, l’ensemble des think tanks classés en 2019 a été automatiquement reconduit dans la sélection de 2020.
Les think tanks qualifiés ont ensuite été soumis à un sondage électronique de classement, officialisé par l’envoi d’un courrier aux participants. Les votes recueillis ont permis d’établir une liste finale de candidats, transmise aux panels d’experts régionaux et fonctionnels afin d’assurer la fiabilité du classement.
Un panel international d’experts, composé de spécialistes issus des différentes régions et domaines couverts par l’évaluation, a ensuite été formé pour finaliser le classement. Après analyse des résultats, ces experts ont soumis leurs recommandations en décembre 2020.
Enfin, le 30 janvier 2021, le rapport final du classement mondial des think tanks a été publié à l’occasion d’événements organisés à New York, Washington D.C. et dans plus de 100 villes à travers le monde
Les think tanks se répartissent en sept grandes catégories selon leur statut et leur mode de fonctionnement : autonomes et indépendants, quasi-indépendants, affiliés à une université, affiliés à un parti politique, affiliés au gouvernement, quasi-gouvernementaux, ainsi que ceux à but lucratif (corporate).
Les critères d’évaluation sont nombreux (un total de 28) et incluent la qualité de la direction, la réputation du personnel, la pertinence des recherches et analyses produites, ainsi que l’impact des publications sur les politiques publiques, etc. Ces critères garantissent la crédibilité et l’objectivité du classement.
Évolution du nombre de Think Tanks entre 2008 et 2020
Le nombre de think tanks a connu une croissance significative entre 2008 et 2020. En 2008, on en recensait 5 465 à travers le monde, tandis qu’en 2020, ce chiffre avait pratiquement doublé pour atteindre 11 175.
Par région, cette évolution se traduit par :
- Amérique du Nord : 1 872 think tanks en 2008 contre 2 397 en 2020.
- Europe : 1 722 en 2008 contre 2 932 en 2020.
- Asie : 653 en 2008 contre 3 389 en 2020.
- Amérique latine et Caraïbes : 538 en 2008 contre 1 179 en 2020.
- Afrique subsaharienne : 424 en 2008 contre 679 en 2020.
- Afrique du Nord et Moyen-Orient : 218 en 2008 contre 599 en 2020.
Montée en puissance de nouveaux acteurs
Les États-Unis : Une domination renforcée
Sans surprise, les États-Unis restent le pays avec le plus grand nombre de think tanks, passant de 1 777 en 2008 à 2 203 en 2020. Cette augmentation témoigne de l’importance continue des institutions de recherche et de réflexion aux États-Unis, qui bénéficient d’un écosystème universitaire et politique très développé.
La Montée en Puissance de la Chine
En 2008, la Chine ne figurait même pas dans le top 10. Pourtant, en 2020, elle s’impose directement à la deuxième place avec 1 413 think tanks. Cette montée en puissance est le reflet d’une volonté stratégique du pays d’accroître son influence intellectuelle et de structurer sa diplomatie et son développement économique via des centres de recherche spécialisés.
L’Inde : Un bond spectaculaire
En 2008, l’Inde comptait 121 think tanks, se classant sixième. En 2020, elle atteint la troisième place mondiale, avec 612 think tanks. Ce développement traduit l’essor du pays en tant que puissance économique et politique, ainsi qu’un intérêt croissant pour l’analyse des politiques publiques.
Le Royaume-Uni et l’Allemagne en perte de vitesse
Le Royaume-Uni, qui occupait la deuxième place en 2008 avec 283 think tanks, se retrouve en quatrième position en 2020, malgré une augmentation significative à 515 think tanks. Cette stagnation relative pourrait être due à des réformes politiques et aux impacts du Brexit.
L’Allemagne, qui comptait 186 think tanks en 2008, n’arrive qu’en septième position en 2020 avec 266 think tanks, dépassée notamment par la Corée du Sud et la France.
La France et la Corée du Sud : Des progressions notables
La France, qui était quatrième en 2008 avec 165 think tanks, se retrouve sixième en 2020, avec 275 think tanks. Ce développement s’explique par une prise de conscience accrue de l’importance des think tanks dans l’élaboration des politiques publiques.
La Corée du Sud n’était pas présente dans le top 10 en 2008, mais se hisse à la cinquième place en 2020 avec 412 think tanks, témoignant de son dynamisme dans le domaine de la recherche stratégique et des politiques économiques.
L’Argentine, le Brésil et le Vietnam dans le Top 10
L’Argentine, qui était déjà présente en 2008 avec 122 think tanks, double presque son nombre en 2020 avec 262 think tanks, occupant ainsi la huitième place.
Le Brésil, absent du classement en 2008, se retrouve neuvième en 2020 avec 190 think tanks, tandis que le Vietnam fait une entrée remarquée en dixième position avec 180 think tanks, illustrant le rôle croissant de l’Asie du Sud-Est dans la réflexion stratégique.
Un Monde en évolution : L’Influence des think Tanks se redessine
Le classement 2020 des think tanks montre une forte progression des pays émergents comme la Chine, l’Inde et la Corée du Sud, tandis que les puissances traditionnelles comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France progressent plus lentement.
Haïti et l’Amérique Latine
Étant intégré dans un classement par région, Haïti fait partie du groupe de l’Amérique latine et centrale. En 2020, cette région comptait 1 179 think tanks, parmi lesquels l’Argentine domine avec 262 groupes de réflexion (contre 122 en 2008), suivie du Brésil avec 190 think tanks (39 en 2008), de la Colombie avec 90 (24 en 2008) et du Chili avec 80(36 en 2008). Ces pays possèdent donc les réseaux de think tanks les plus développés de la région.
Les budgets alloués à ces institutions sont également conséquents. Selon une étude menée par l’Université de Pennsylvanie, l’Argentine investit 671 000 dollars, tandis que le Brésil y consacre 3 751 663 dollars et la Colombie 862 088 dollars.
Un autre point notable est que la majorité des think tanks de cette région sont autonomes et indépendants. Leurs domaines de recherche prioritaires concernent principalement la corruption, le crime organisé, la montée du populisme, la pandémie de Covid-19, les avancées technologiques et les coopérations nationales et internationales.
Haiti et la république dominicaine
Lors de la première édition du classement en 2008, Haïti ne comptait que deux think tanks, tandis que la République dominicaine en recensait 13. À cette époque, le Belize et le Suriname n’en comptaient aucun.
Douze ans plus tard, la République dominicaine a connu une expansion significative, atteignant 41 think tanks en 2020. Haïti, quant à lui, est passé à trois groupes de réflexion selon le TTCSP, tandis que le Belize, autrefois absent du classement, en compte désormais cinq.
Concernant les financements alloués, la République dominicaine investit 93 667 dollars dans ces structures et leurs recherches. Pour Haïti, aucun montant n’a été communiqué, car les fonds alloués étaient trop faibles pour répondre aux standards requis dans l’étude.
Les Think Tanks haïtiens et leur impact
Le MODRICENIR (Monde de Diplomatie, Relations internationales et Commerce international, Coopération externe, Notation et Classement socio-économique et Réputation internationale) se distingue comme l’un des principaux think tanks haïtiens, régulièrement classé parmi les entités de réflexion les plus influentes. Fondé en Haïti, ce groupe de réflexion est dirigé par le Lieutenant Général à la retraite et ancien Ministre des Affaires Étrangères, Herard Abraham, ainsi que par le Professeur Dr Emmanuel Justima, figures emblématiques de cette structure. Selon les critères de qualification du classement, le think tank joue un rôle primordial dans la production de savoirs, la réalisation d’études et la contribution à la vie scientifique du pays.
Cependant, le constat demeure préoccupant : les groupes de réflexion restent rares en Haïti, un pays confronté à de multiples difficultés socio-économiques. L’absence de financement pour la réalisation de recherches approfondies constitue un obstacle majeur à l’essor de ces structures. Malgré cela, de jeunes intellectuel(le)s et institutions, comme Haiti Efficace, une firme de consultation dirigée par l’économiste haïtien Etzer Emile, ou encore le think tank Policitédirigé par les jeunes professionnels haïtiens Emmanuela Douyon, Yvens Rumbold et Stevens Simplus, s’efforcent de faire la différence. Ces groupes se concentrent sur des études portant sur des secteurs clés tels que l’agriculture, l’économie et l’éducation, tout en formulant des recommandations destinées à éclairer les décisions politiques.
Un autre acteur de la scène intellectuelle haïtienne est le Think Tank Haïti, une collaboration entre l’Université Quisqueya et le Dialogue Inter-Américain. Ce partenariat vise à créer un réseau d’éminents universitaires et chercheurs, en majorité d’Haïti, des États-Unis et du Canada, dans le but de développer des propositions politiques concrètes pour relever les défis d’Haïti, en particulier en matière de progrès économique, social et politique, tout en protégeant les droits des groupes vulnérables.
Par ailleurs, le think tank GRAHN, fondé le 20 janvier 2010 par le Professeur Samuel Pierre, représente une autre initiative importante dans le domaine. Bien que basé au Canada, il étend son influence en Haïti, en France, aux États-Unis et en Suisse, et œuvre pour la construction de solutions pratiques aux problèmes haïtiens.
Malgré les efforts louables de ces différentes structures, la tâche demeure ardue. L’accès aux données chiffrées et la difficulté de vérifier si les think tanks respectent les critères requis compliquent l’évaluation exacte du nombre de ces entités en Haïti. De plus, de nombreuses initiatives étudiantes et universitaires, bien qu’ambitieuses, ne sont pas encore reconnues légalement en raison des contraintes juridiques.
Si la volonté est présente, la mise en œuvre de ces projets nécessite des ressources humaines considérables et un financement substantiel, car la recherche de qualité est un investissement coûteux, mais nécessaire pour produire des expertises fiables et rigoureuses.
Roodelin Charlotin
Latest Blog
-
Évolution des Think Tanks et leur classement mondial : le cas Haïtien11 Fév 2025
-
 L’Iran l’équation complexe de l’administration américaine12 Déc 2024
L’Iran l’équation complexe de l’administration américaine12 Déc 2024 -
 L’OTAN, une alliance militaire qui ravive la guerre froide12 Déc 2024
L’OTAN, une alliance militaire qui ravive la guerre froide12 Déc 2024 -
 Espace Etudiant était à l’INAGHEI, l’Iran et les Etats-Unis étaient au rendez-vous12 Déc 2024
Espace Etudiant était à l’INAGHEI, l’Iran et les Etats-Unis étaient au rendez-vous12 Déc 2024
